« Et pendant cette soirée du 19 [mai 1916] (soirée d’angoisse et de tristesse), l’on nous a distribué à chacun 4 boîtes de singe, 48 biscuits et 300 cartouches, tout un fourbi qui nous donnait le cafard ; ça commençait à sentir mauvais car les munitions que l’on donnait, ainsi que les vivres, n’étaient sans doute pas pour aller au grand repos ».
François Barge, Avoir vingt ans dans les tranchées, Saint-Pourçain-sur-Sioule, C.R.D.P., 1984, p. 17.
Les deux journées d’études intitulées « Manger et boire entre 1914 et 1918 » qui viennent de s’achever ce week-end à la bibliothèque municipale de Dijon, – une des plus riches bibliothèques du territoire en matière gastronomique et de cartes de menus !, sont l’occasion pour Le cœur au ventre de revenir sur ce que fut la réalité alimentaire et donc gastronomique des soldats en ces années de vaches maigres. Il est quand même étonnant que la mission du centenaire n’ait pas plus communiqué sur un sujet aussi passionnant : celui de l’approvisionnement des troupes et de l’alimentation des soldats en temps de guerre.

Albert Guillaume. Une de « La Baïonnette », n° du 6 janvier 1916. BM Dijon. Est. 2170. Journal satirique parisien, La Baïonnette est fondée en janvier 1915 et disparaîtra des kiosques en 1920.
L’ordinaire
Que mange et boit un poilu durant la Grande Guerre ?
« Les difficultés matérielles du ravitaillement en première ligne sont une des graves complications du séjour aux tranchées, tant pour le transport des vivres que pour leur distribution, qui s’opèrent le plus souvent à la nuit ou au demi-jour ; les Poilus ne l’ignorent pas ». Ainsi témoigne le Dr Henri Chatinière dans son ouvrage intitulé Pour sa santé – Ce qu’un Poilu doit savoir, (source : Gallica) imprimé un an avant les grandes désertions de 1917. L’auteur poursuit : « La propreté des cuisiniers laisse grandement à désirer, et leur éducation à cet égard est nulle. Ils sont sales et ont les mains sales ; ils manient les vivres avec la plus entière incurie, les laissant traîner à terre ou sur des sacs immondes (…). Mais on ne saurait s’étonner : des odeurs de graillon qui infectent soupes et ragoûts, des fermentations productrices d’une écume effervescente au sein des marais de lentilles, des parfums inédits tels que le pétrole assaisonnant plusieurs repas successifs… ».
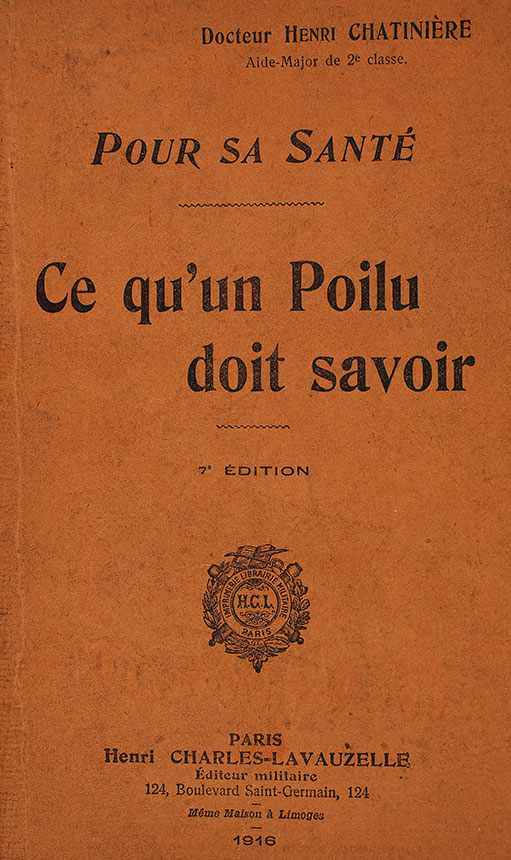
Henri Chatinière. Pour sa santé : ce qu’un poilu doit savoir. Parsi : Henri Charles-Lavauzelle, 1916 (6e éd.). BM Dijon, Muteau I-14/18 (175).
En 1914, la ration journalière du soldat est composée de 700 g de pain ou 700 g de biscuit, 600 g de viande fraîche ou congelée, 100 g de légumes secs ou de riz, du sel, du poivre et du sucre, et 24 à 36 g de café torréfié… En France, « c’est paradoxalement chez les combattants que la consommation de viande augmente le plus » affirme Emmanuelle Cronier, universitaire et chercheuse, spécialiste de l’alimentation durant la Grande guerre. Le soldat dispose également de ration de combat, composée de 300 g de biscuit dit « pain de guerre », et de 300 grammes de viande de bœuf en conserve ou « singe », similaire au corned beef anglo-saxon. La conserve améliore également la mobilité des troupes, mais les contaminations et empoisonnements ne sont pas rares.
Terme péjoratif, le « singe » semble avoir pour origine la fréquentation des troupes coloniales par les soldats de métropole. Ces derniers leur auraient raconté avoir vu des Africains manger du singe boucané…
La principale nourriture du fantassin-paysan ou du fantassin-ouvrier reste, comme avant-guerre, le pain, d’abord blanc, puis très vite gris en raison des pénuries. Côté allemand, c’est encore pire, le pain noir dit « K.K. » (Kriegs Kartoffelbrot) et les rutabagas servis aux popotes teutonnes font jalouser les soldats français, mieux lotis. Et le mal allemand est encore plus profond : le blocus continental depuis 1914 et la malnutrition ambiante auraient entraîné la mort de 700 000 civils durant la guerre… rien que ça. Pour la boisson, rien ne remplace le « pinard », d’un degré d’alcool plus faible qu’aujourd’hui. La guerre a résorbé la surproduction de vin d’avant-guerre et a permis aussi de développer la vigne en Algérie. La consommation moyenne journalière dans les rations passe de 25 cl au début de la guerre à 1 litre en 1918, au moment où le moral des troupes est au plus bas…
L’extraordinaire
Aux longs moments de cafard répondent parfois quelques heureuses folies hédonistes passagères, que ce soit dans les tranchées, en cantonnement à l’arrière, ou lors des trop rares permissions loin du front, loin des larmes, du vacarme, des rats et du mortel ennui. La chasse au gibier au fusil d’assaut, même entre les lignes ennemies, exercice qui devient « une séance de tirs internationaux » dans le No man’s land désertique et tout retourné de terre et de gravats, est un vrai sport et rappelle un peu la liberté du temps d’avant. La pose de collets et le braconnage sont courants, rarement sanctionnés par les officiers malgré leur interdiction, cela va de soi. La pêche à la ligne a ses adeptes, mais le matériel se fait rare : on préfère la grenade et la dynamite pour récolter le poisson, quitte à dévaster les réserves locales…
Parmi les très riches documents conservés à la bibliothèque municipale de Dijon, on trouve ce menu de fête organisé par la très sérieuse « S.P.L.D.D.B. », « Société pour la Destruction des Boches » (il fallait l’inventer !), qui propose le 12 décembre 1915 des huîtres Marennes premier choix, un potage vermicelle, des sardines-beurre, un civet de garenne, haricots-beurre, une dinde aux marrons, salade, fromages, pruneaux, pâtisseries, café et liqueurs. Preuve que tout n’allait parfois pas si mal sur le front, mais ces jours-là étaient bien entendu exceptionnels…

Menu du 24 juin 1917. Illustration ronéotypée représentant un poilu en serveur apportant un plat dans une cagna. BM Dijon, M II-2917.
Soutenant le moral des troupes, les colis envoyés des lointaines provinces par les familles sont l’occasion de parler « spécialités régionales » entre soldats. C’est sans doute aussi le moment de prendre conscience de la richesse gastronomique de la France… et de ses colonies pour beaucoup de citoyens-combattants. Une prise directe sur l’altérité des goûts, de la diversité des terroirs, des recettes de familles, et finalement, d’une certaine France de la gastronomie, aussi paysanne soit-elle. Au plan national, cette découverte des diversités gastronomiques aura sans doute de grandes répercussions durant l’entre-deux-guerres, notamment sur la montée en puissance des cuisines régionalistes et des chefs associés, même si cela reste difficile à quantifier. Certaines entreprises commercialisent déjà des paquets tout prêts envoyés aux combattants par leurs proches. Le chocolat est une valeur sûre, comme on le verra avec l’épopée Banania. Les soldats peuvent également acheter directement ces colis dans les coopératives qui leur sont réservées.
« Cette question du choix des aliments nous amène à glisser ici un paragraphe sur les colis familiaux, généralement garnis de victuailles : leur composition est souvent inénarrable, un vrai poème ! (…) Voici entre autres un exemple authentique des associations imprévues qui s’y rencontrent : dans une paire de chaussettes, une saucisse sèche, du chocolat, du beurre, un fromage avancé, quelques gâteaux secs ; un pot de confitures dans une boîte en carton, une provision de tabac à priser et des cigares ; sans compter, bien entendu, deux fioles sournoises, l’une d’alcool de menthe, l’autre d’eau-de-vie de marc (…) ».
Dr Henri Chatinière, Pour sa santé – Ce qu’un Poilu doit savoir, Paris, 1916, p. 43

Menu de déjeuner, au nom du général Pétain (vers 1917-1918). Aquarelle représentant un soldat allemand se rendant. BM Dijon, M IV-917.
Les mots pour le dire : l’argot culinaire des tranchées
L’argot militaire (lire le document mis en ligne par le CRID 14-18) utilisé il y a cent ans – dont certains termes nous sont restés – est lui aussi assez émouvant. Le « barbelé » fait référence à l’eau-de-vie ou gnôle, le « rata » (contraction de « ratatouille »), un modeste ragoût à base de pommes de terre ou de haricots, souvent plat unique sur le front, le « jus » pour le café – le mot est resté, la « popote » ou « roulante », les cuisines roulantes mises en place à partir de 1915 pour alimenter les premières lignes, très utiles après que les mercantis, ces profiteurs de bas étage des communes voisines aux affrontements, vendant leur gnôle ou piquettes à la sauvette, soient éloignés pour un temps. La nourriture est acheminée ensuite des cuisines via des marmites appelées « boutéons » ou « bouteillons ». Le mot « caviarder » fait référence aux raturages dans les lettres ou passages censurés par les commissions de contrôle postal. Quant aux « citrons » et aux « marmites », ce sont les grenades individuelles et les bombes allemandes vues du côté français. Enfin, les « saucisses » et les « pieds de cochon » ne sont autres que les ballons d’observation ennemis et les piquets à vis servant à installer le plus discrètement possible et de nuit les barbelés…
« Malgré la mort qui nous suit et prend quand elle veut ceux qu’elle veut, une confiance insensée nous reste. Ce n’est pas vrai, on ne meurt pas ! Est-ce qu’on peut mourir, quand on rit sous la lampe, penchés sur le plat d’où monte un parfum vert de pimprenelle et d’échalote ? »
Roland Dorgelès, Les croix de bois, Albin Michel, 1919.

Joueurs de dames daté de novembre 1914 (non identifié). Dessin original de ma collection personnelle.



Le sujet me passionne et fera doreanavant figure de reference !
Très honoré ! N’hésitez pas à partager et à aimer la page Facebook !!!
Bien cordialement,
Olivier
Votre article ne m’a pas du tout laissé indifférent ! merci
Très intéressant
j’aimerais vous en parler
filmoberfeld@gmail.com
merci
plutot interressant mais j’aimerais savoir de quelle marque le pinard ? nan parce que y’a eut un probleme en 1916 le 2janvier avec a peu près 234 bouteilles périmées qui auraient entrainés des dizaines de rats morts apres avoir manger la chair des poilus le pinard était tellement périmé que la plupart d’entre eux mourrais d’une chiasse foudroyante
Trés interessant mon profs d’histoire m’avait raconter la même chose cependant je doute qu’il n’y ait eu que 234 bouteille il me semble que plus de 1000 on été crée avec ce probléme
Bonjour,
Merci pour toutes ces informations, bien intéressantes!
j’ai retrouvé sur une carte de mon grand père dans les Balkans, un texte où il mentionne que so ordinaire est fait de «singe» (bien connu) et de «marocain»… savez vous ce que ce terme signifie?
Bonsoir,
Et merci du compliment ! Je ne connais pas le terme » marocain » et ne l’ai jamais croisé…
Je vais creuser la question, mais je pense qu’il y a un peu de racisme là-dedans, comme il était en usage à cette époque, les colonisés étant jugés alors inférieurs, et donc » bon à manger « .
Merci encore et à bientôt sur Le cœur au ventre !
N’hésitez pas à le faire connaître autour de vous !
Cordialement,
Olivier
Bonjour,
Mon grand-père (que j’ai connu, j’ai 70 ans) mobilisé à 40 ans le 3 août 1914, était boucher à Vitry sur Seine.
Il a très vite été autour de Verdun, en particulier au Fort de Tavannes. J’ai de très nombreuses lettres et cartes postales de lui de 1914 à 1918. Je comprends qu’il devait ravitailler en viandes et même souvent cuisiner.
Je pense qu’il parcourait la campagne pour trouver les animaux (vaches principalement) les tuer, récupérer les peaux, découper … Il raconte qu’il cuisine chez une grand-mère.
Avez-vous des infos qui expliquent cette mission ? J’espère pouvoir organiser une expo-conférence pour novembre 2018.
Avec mes vifs remerciements.
Bonsoir et merci pour votre très émouvant commentaire. Si nous pouvions nous rencontrer pour en parler et que je puisse voir vos documents, peut-être aurions-nous le début d’une réponse. Cette mission des bouchers et cuisiniers sur le front est, je pense, encore assez inconnue. Je me renseigne.
Bien à vous et très cordialement,
Olivier
J’ écris un livre sur mon grand-père en 14 . C’est sa boîte de singe qui l’a sauvé un jour.
Bonjour, je prévois début novembre 2018 une expo-conférence-spectacle, GRATUITE, dans l’Yonne, sur mon grand-père Gabriel OTTELLO qui était à Verdun de 1914 à 1918, basé au Fort de Tavannes, boucher-tueur, au ravitaillement, hors rang.
Je possède une centaine de ses lettres, ses dessins, des documents.
Me permettez-vous de reprendre quelques lignes et éventuellement la première photo ? Je citerai la source.
Peut-être pouvez-vous m’aider sur la viande congelée, les boites de singe, les popotes, …
Je peux aussi vous envoyer des documents.
Bonsoir François,
Je réponds un peu tard, mais vous remercie pour votre très sympathique message.
Il va de soi que je suis partant pour vous aider si je le peux. N’hésitez donc pas à citer mes sources avec mon crédit bien sûr !
Envoyez-moi en privé les documents dont vous me parlez. Cela m’intéresse au plus haut point. L’occasion d’écrire un nouvel article et de nous voir à Paris pourquoi pas ?
Bien à vous et avec toute ma belle sympathie.
Olivier
Que mangeaient ils pendant la bataille de Verdun en 1916 au milieu de la guerre quand ils n’avaient pas de ravitaillements
Bonsoir Apolline,
M’est avis qu’ils ne mangeaient pas grand chose. Néanmoins, le ravitaillement avait lieu tous les jours, sauf pour les troupes directement exposées au front…
Bonne soirée et à bientôt sur Le Cœur au ventre !
Bien à vous,
Olivier
Bonjour,
Quelle était la ration quotidienne d’eau des soldats? Vous parlez du vin mais pas de l’eau.
Vers 1914, l’eau était bien sûr encore un problème par rapport aux bactéries et autres infections. Cela explique la consommation de vin et d’alcool. J’avoue ne rien savoir sur la consommation d’eau des poilus, mais m’est avis qu’elle était négligeable. Les hommes étaient bien certainement habitués à consommer autre chose dans les tranchées…
Bonne soirée et à bientôt sur Le cœur au ventre !
Une autre explication, concernant le «singe» a été donnée par Philippe Gloaguen ce 21 janvier 2022 sur France-Culture. La voici :
Si on disait que les soldats mangeaient « du singe », c’est parce qu’il y avait des musulmans dans l’armée (notamment des Africains) et que la viande qui leur était fournie en conserve était (parfois) du porc ; il ne fallait donc pas qu’il sachent qu’on leur faisait manger une viande interdite par leur religion ; les mots «porc» et «cochon» étaient proscrits.
Philippe Gloaguen, passionné d’Histoire, tient cette explication de son père.
Cher Monsieur,
Merci pour votre commentaire très instructif !!! Je ne connaissais pas cette histoire… A bientôt sur Le cœur au ventre !
A bientôt !
Cordialement,
Olivier